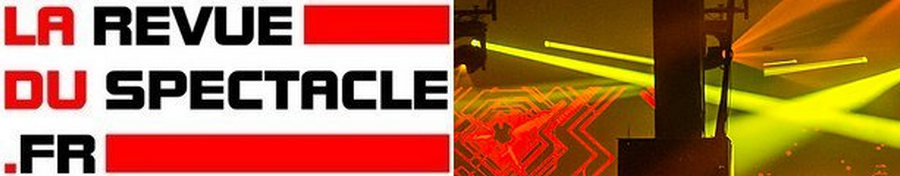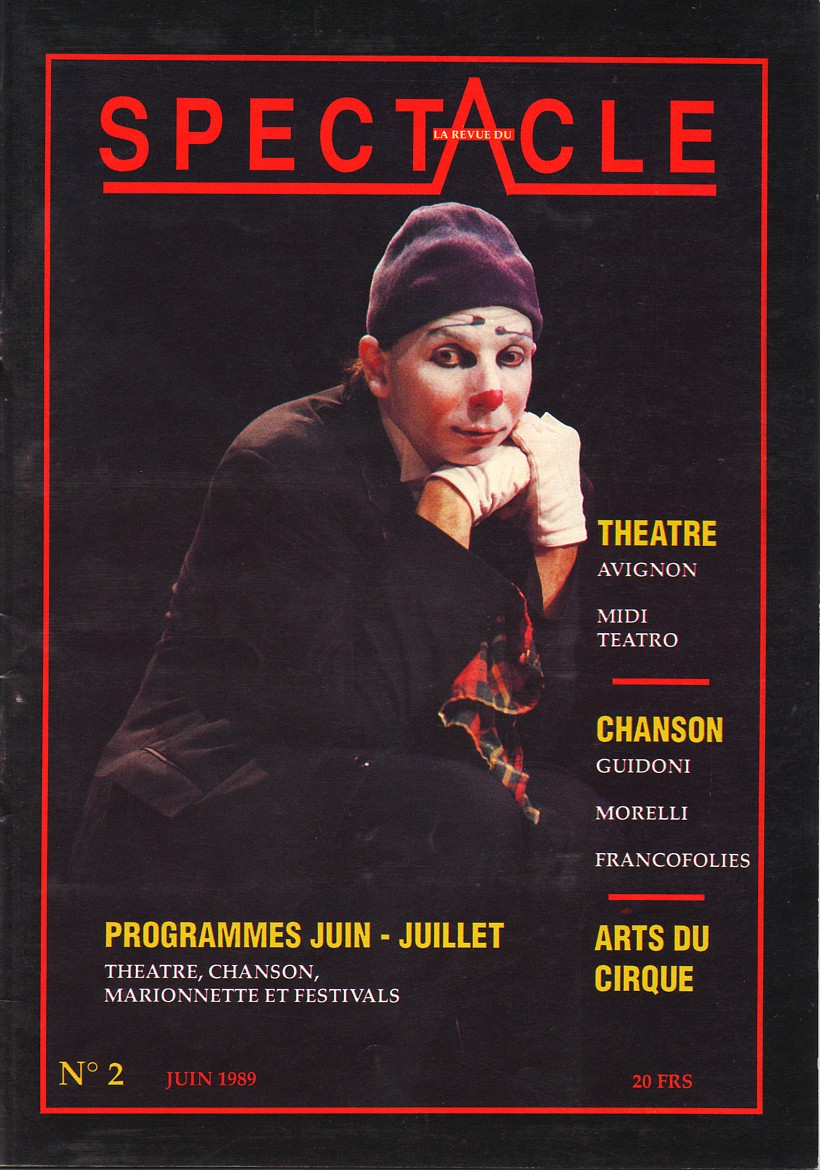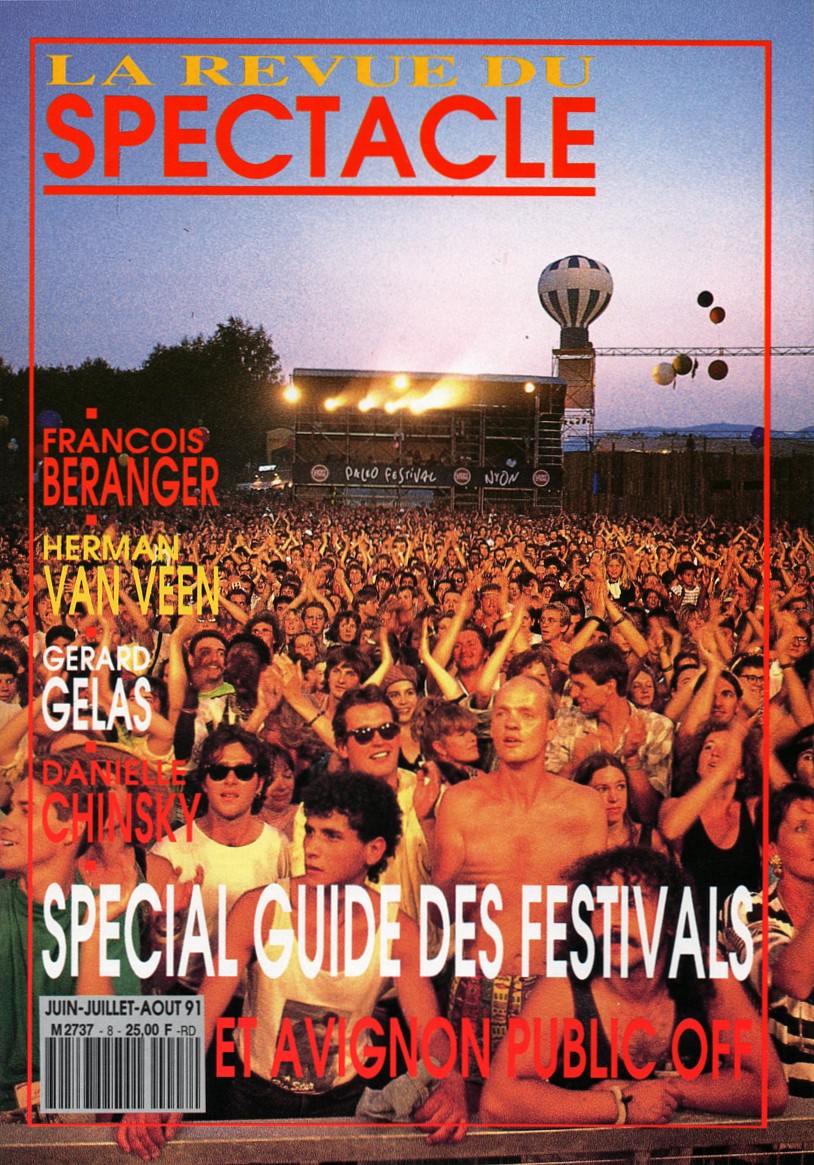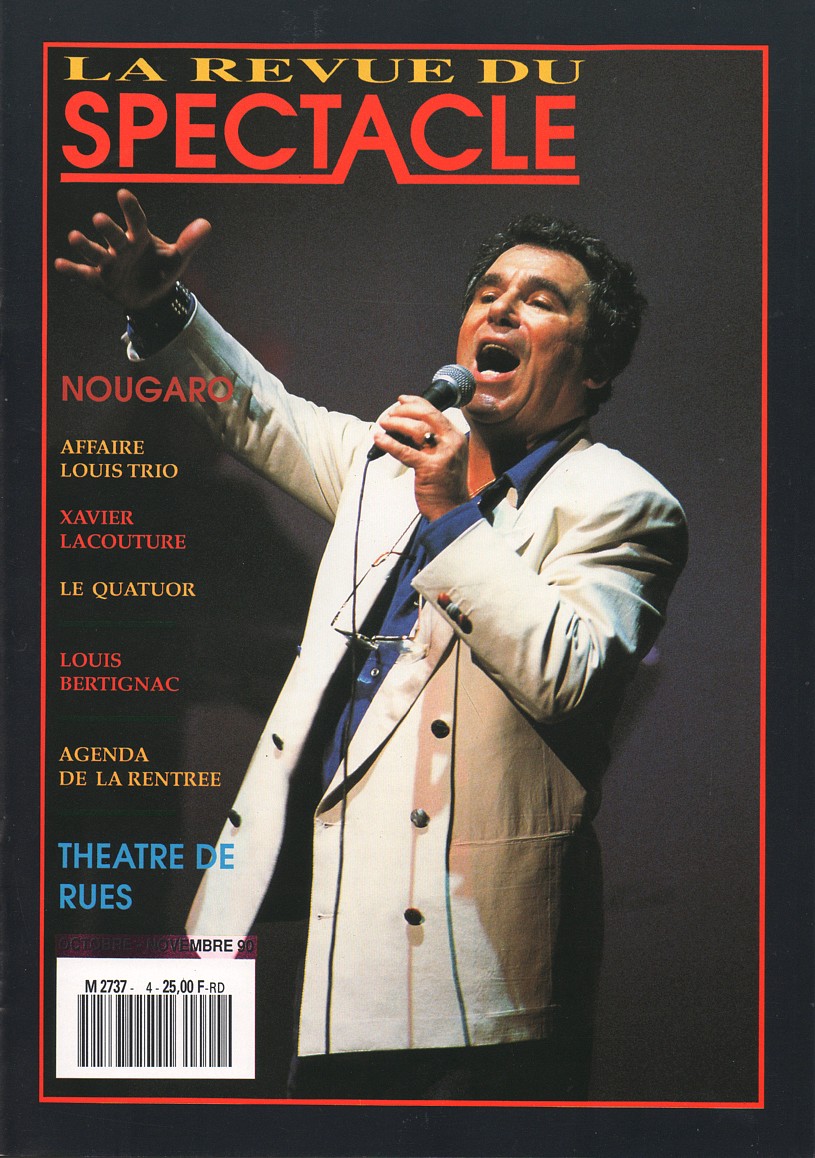Peter Mattei (Don Giovanni) et Gaëlle Arquez (Zerlina) © Charles Duprat.
Michael Haneke a choisi de nous parler de nous, de notre monde contemporain à travers l’opéra le plus admiré de W. A. Mozart. Cette rencontre étonnante mais fertile des deux génies autrichiens est due au précédent directeur de l’Opéra, Gérard Mortier, qui a su faire résonner la modernité de tant de chefs-d’œuvre par un choix très intelligent et parfois polémique des équipes artistiques, pendant son mandat.
Notre monde ? C’est celui de la désespérance métaphysique, espace raréfié où se constate le néant de nos existences, dans l’œuvre de Michael Haneke, comme sur la scène. C’est bien à l’esprit de l’opéra qu’est fidèle le metteur en scène autrichien : le livret de Lorenzo da Ponte a été écrit "la nuit en lisant quelques pages de L’Enfer de Dante".* N’en déplaise aux quelques spectateurs qui ont sifflé l’abandon pertinent de la lettre de l’œuvre : en l’espèce, le choix de la transposition dans le monde apocalyptique de l’après-crise mondiale du XXIe siècle de l’intrigue du livret, avec des personnages que nous côtoyons dans la rue ou voyons sur nos écrans. Ce sont bien des appétits luxurieux (i.e. soif d’argent et copulation étroitement liées) dont il est question, de la violence ordinaire et sourde qui traverse les milieux les plus policés, les plus cultivés, l’élite financière et politique. Ce que dévoile la production, c’est la lutte des classes implacable et dérisoire que se livrent nos contemporains - comme les personnages. Et c’est brillant.
Notre monde ? C’est celui de la désespérance métaphysique, espace raréfié où se constate le néant de nos existences, dans l’œuvre de Michael Haneke, comme sur la scène. C’est bien à l’esprit de l’opéra qu’est fidèle le metteur en scène autrichien : le livret de Lorenzo da Ponte a été écrit "la nuit en lisant quelques pages de L’Enfer de Dante".* N’en déplaise aux quelques spectateurs qui ont sifflé l’abandon pertinent de la lettre de l’œuvre : en l’espèce, le choix de la transposition dans le monde apocalyptique de l’après-crise mondiale du XXIe siècle de l’intrigue du livret, avec des personnages que nous côtoyons dans la rue ou voyons sur nos écrans. Ce sont bien des appétits luxurieux (i.e. soif d’argent et copulation étroitement liées) dont il est question, de la violence ordinaire et sourde qui traverse les milieux les plus policés, les plus cultivés, l’élite financière et politique. Ce que dévoile la production, c’est la lutte des classes implacable et dérisoire que se livrent nos contemporains - comme les personnages. Et c’est brillant.

Bernard Richter (Don Ottavio), Patricia Petibon (Donna Anna), Nahuel Di Piero (Masetto), Gaëlle Arquez (Zerline) © Charles Duprat.
Don Giovanni, dans sa quête prédatrice des "ragazze" (des "femmes", corollaire d’une féroce guerre économique donc), humilie tant et plus tous ceux et celles qu’il croise et domine, jusqu’à l’équipe de nettoyage du building. Il est aidé par son jeune complice et assistant, Leporello, animé d’un désir mimétique - au sens entendu par René Girard** - et même homosexuel pour son chef. Entres divers "troussages de domestiques" et autres horreurs, Don Giovanni essaie de séduire Zerline, fêtant son mariage avec Masetto (de paysans dans le livret, ils sont devenus sur la scène de Bastille de jeunes travailleurs immigrés venus des pays de l’Est), dans les ténèbres d’un plateau où les vitres de l’immeuble font miroir (mention spéciale aux lumières d’André Diot).
Le public plutôt bourgeois du parterre et des premières loges s’y reflètent, s’y retrouvent et se confondent avec les personnages sur scène, selon un dispositif aussi polémique que réjouissant. Les victimes de Don Juan (puisque c’est lui) se recrutent dans l’élite mais aussi dans les couches prolétariennes de la société. Des représentants des minorités - comme on dit - ont été choisis comme figurants sur le plateau, redoublant un incroyable effet de réel pour le spectateur. De ces minorités qu’on n’a pas trop l’habitude de voir à Bastille ou à Garnier. Insolence dans la manière de mettre les points sur les "i" bien dans la manière du sulfureux Michael Haneke.
Le public plutôt bourgeois du parterre et des premières loges s’y reflètent, s’y retrouvent et se confondent avec les personnages sur scène, selon un dispositif aussi polémique que réjouissant. Les victimes de Don Juan (puisque c’est lui) se recrutent dans l’élite mais aussi dans les couches prolétariennes de la société. Des représentants des minorités - comme on dit - ont été choisis comme figurants sur le plateau, redoublant un incroyable effet de réel pour le spectateur. De ces minorités qu’on n’a pas trop l’habitude de voir à Bastille ou à Garnier. Insolence dans la manière de mettre les points sur les "i" bien dans la manière du sulfureux Michael Haneke.

Peter Mattei (Don Giovanni) et David Bizic (Leporello) © Charles Duprat.
Et pour la représentation de ce samedi, les faits viennent confirmer la lecture qui est faite de l’œuvre, vraie métaphore de notre temps : certains spectateurs sont obligés à l’entracte d’effectuer un long détour dans la rue pour rejoindre le bar (on les met dehors !) en raison d’un cocktail offert par un mécène à certains privilégiés au rez-de-chaussée, dans un espace "interdit". C’est bien à une guerre de territoire (corps, biens et lieux) que se livrent les classes sociales dans ce "Don Giovanni", sur scène et hors scène ! Michael Haneke n’a pu assister à cette miraculeuse confirmation de son propos, et c’est dommage !
Don Giovanni, c’est le baryton suédois Peter Mattei, fatal et sexuel, dont la haute silhouette domine tous les rôles. Fascinant oiseau de proie sauvage et érotique, il a la noblesse et la morgue du "héros". Il maîtrise le rôle de bout en bout, il est grandiose, il est irrésistible. Leporello - savoureux David Bizic - traîne son ironie, ses angoisses et son sac Fauchon dans les traces de son dangereux "maître". Il s’agit de thésauriser, consommer, consumer dans cette vision haletante, nerveuse et postmoderne de l’opéra. Sur une scène souvent désertée, où errent des personnages narcissiques ou/et exploités, l’humiliation est la règle et l’amour vrai, l’exception. Donna Elvira - émouvante Véronique Gens -, collègue séduite et abandonnée, ne pourra ramener à la raison ce fou furieux, cet excité arrogant de Don Giovanni.
Don Giovanni, c’est le baryton suédois Peter Mattei, fatal et sexuel, dont la haute silhouette domine tous les rôles. Fascinant oiseau de proie sauvage et érotique, il a la noblesse et la morgue du "héros". Il maîtrise le rôle de bout en bout, il est grandiose, il est irrésistible. Leporello - savoureux David Bizic - traîne son ironie, ses angoisses et son sac Fauchon dans les traces de son dangereux "maître". Il s’agit de thésauriser, consommer, consumer dans cette vision haletante, nerveuse et postmoderne de l’opéra. Sur une scène souvent désertée, où errent des personnages narcissiques ou/et exploités, l’humiliation est la règle et l’amour vrai, l’exception. Donna Elvira - émouvante Véronique Gens -, collègue séduite et abandonnée, ne pourra ramener à la raison ce fou furieux, cet excité arrogant de Don Giovanni.

© Charles Duprat.
Le Commandeur, ou fantôme du patron, ne réapparaît à la fin que pour mieux afficher son impuissance à "moraliser le capitaliste" séducteur, affalé qu’il est dans son fauteuil roulant. C’est l’équipe de nettoyage, prolétaires poussés à bout et en révolte, qui jette Don Giovanni par la fenêtre, révélant l’impossible châtiment transcendant de celui qui mettait un peu trop à jour la vérité des êtres : mélange de pulsions d’autodestruction et jouissance libidineuse de destruction des autres.
Le "dramma giocoso" (ou drame joyeux) de l’enfant prodige n’a jamais été si bien monté dans sa noirceur : les scènes du plus haut comique (travestissement, échange des rôles, quiproquos, etc.) se teintent d’amertume ici, se heurtent à un rythme endiablé - et sans solution de continuité - aux scènes les plus implacablement tragiques. L’allegro le plus effréné, caractérisant le rôle de Don Giovanni (et sa quête obsessionnelle du plaisir), les parties typiquement "buffa" (ou burlesques) de Leporello luttent contre les accords puissants, dramatiques, solennels (dans la tonalité en ré mineur du "Requiem", pour la tragédie annoncée dès l’ouverture) ou encore contre les accents élégiaques des arias féminins. Musique de bout en bout passionnante.
On se souviendra de la Donna Anna de Patricia Petitbon, superbe prima donna colorature. On se souviendra aussi de la direction de Philippe Jordan (37 ans) dont on chante régulièrement les louanges ici (c’est vrai) mais qui est en train de s’imposer comme le chef le plus doué de sa génération. Des preuves ? Il dirige ce mois-ci le Philharmonique de Vienne (c’est-à-dire le meilleur orchestre du monde)... Et c’est la consécration en juillet... Il va diriger son premier "Parsifal" à Bayreuth, le temple wagnérien.
La meilleure production de l’Opéra de Paris cette année (mais c’est une reprise de 2006…).
*"Mémoires" de Lorenzo da Ponte, 1830.
**"Mensonge romantique et vérité romanesque" de René Girard, 1961.
Le "dramma giocoso" (ou drame joyeux) de l’enfant prodige n’a jamais été si bien monté dans sa noirceur : les scènes du plus haut comique (travestissement, échange des rôles, quiproquos, etc.) se teintent d’amertume ici, se heurtent à un rythme endiablé - et sans solution de continuité - aux scènes les plus implacablement tragiques. L’allegro le plus effréné, caractérisant le rôle de Don Giovanni (et sa quête obsessionnelle du plaisir), les parties typiquement "buffa" (ou burlesques) de Leporello luttent contre les accords puissants, dramatiques, solennels (dans la tonalité en ré mineur du "Requiem", pour la tragédie annoncée dès l’ouverture) ou encore contre les accents élégiaques des arias féminins. Musique de bout en bout passionnante.
On se souviendra de la Donna Anna de Patricia Petitbon, superbe prima donna colorature. On se souviendra aussi de la direction de Philippe Jordan (37 ans) dont on chante régulièrement les louanges ici (c’est vrai) mais qui est en train de s’imposer comme le chef le plus doué de sa génération. Des preuves ? Il dirige ce mois-ci le Philharmonique de Vienne (c’est-à-dire le meilleur orchestre du monde)... Et c’est la consécration en juillet... Il va diriger son premier "Parsifal" à Bayreuth, le temple wagnérien.
La meilleure production de l’Opéra de Paris cette année (mais c’est une reprise de 2006…).
*"Mémoires" de Lorenzo da Ponte, 1830.
**"Mensonge romantique et vérité romanesque" de René Girard, 1961.
"Don Giovanni"

© Charles Duprat.
Spectacle vu le samedi 14 avril 2012.
Dramma giocoso en deux actes.
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart.
Livret : Lorenzo Da Ponte.
Direction musicale :
Philippe Jordan (15, 18, 21, 23, 25 mars, 3, 8, 12, 14 avril) ;
Marius Stieghorst (16, 19, 21 avril).
Mise en scène : Michael Haneke.
Décors : Christoph Kanter.
Costumes : Annette Beaufaÿs.
Lumières : André Diot.
Chef de chœur : Alessandro Di Stefano.
Avec : Peter Mattei (Baron Don Giovanni), Paata Burchuladze (Il Commendatore), Patricia Petibon (Donna Anna), Bernard Richter (Don Ottavio, 15, 18, 21, 23, 25 mars, 3 avril), Saimir Pirgu (Don Ottavio, 8, 12, 14, 16, 19, 21 avril), Véronique Gens (Donna Elvira), David Bizic (Leporello), Nahuel Di Pierro (Masetto), Gaëlle Arquez (Zerlina).
Durée : 3 h 40 avec un entracte.
Du 15 mars au 21 avril 2012.
À 19 h 30.
Opéra Bastille, Paris 12e, 01 73 60 26 26.
>> operadeparis.fr
Dramma giocoso en deux actes.
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart.
Livret : Lorenzo Da Ponte.
Direction musicale :
Philippe Jordan (15, 18, 21, 23, 25 mars, 3, 8, 12, 14 avril) ;
Marius Stieghorst (16, 19, 21 avril).
Mise en scène : Michael Haneke.
Décors : Christoph Kanter.
Costumes : Annette Beaufaÿs.
Lumières : André Diot.
Chef de chœur : Alessandro Di Stefano.
Avec : Peter Mattei (Baron Don Giovanni), Paata Burchuladze (Il Commendatore), Patricia Petibon (Donna Anna), Bernard Richter (Don Ottavio, 15, 18, 21, 23, 25 mars, 3 avril), Saimir Pirgu (Don Ottavio, 8, 12, 14, 16, 19, 21 avril), Véronique Gens (Donna Elvira), David Bizic (Leporello), Nahuel Di Pierro (Masetto), Gaëlle Arquez (Zerlina).
Durée : 3 h 40 avec un entracte.
Du 15 mars au 21 avril 2012.
À 19 h 30.
Opéra Bastille, Paris 12e, 01 73 60 26 26.
>> operadeparis.fr