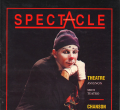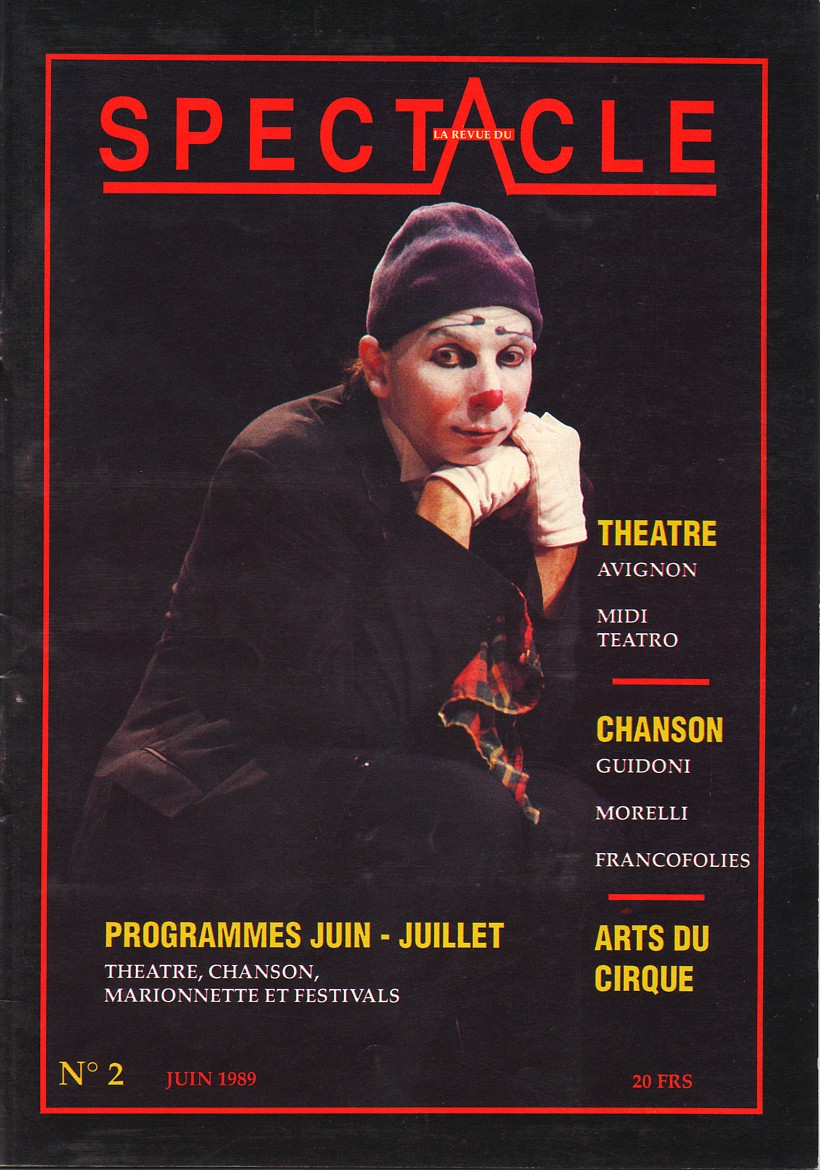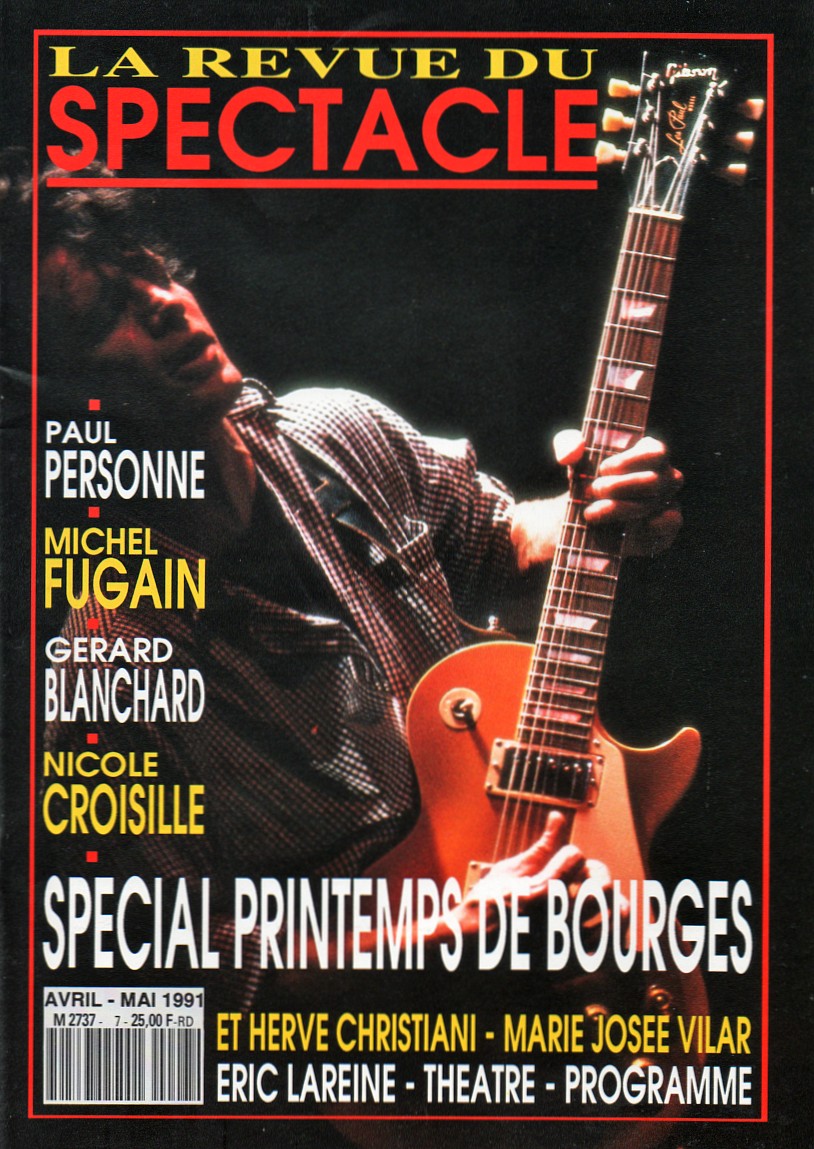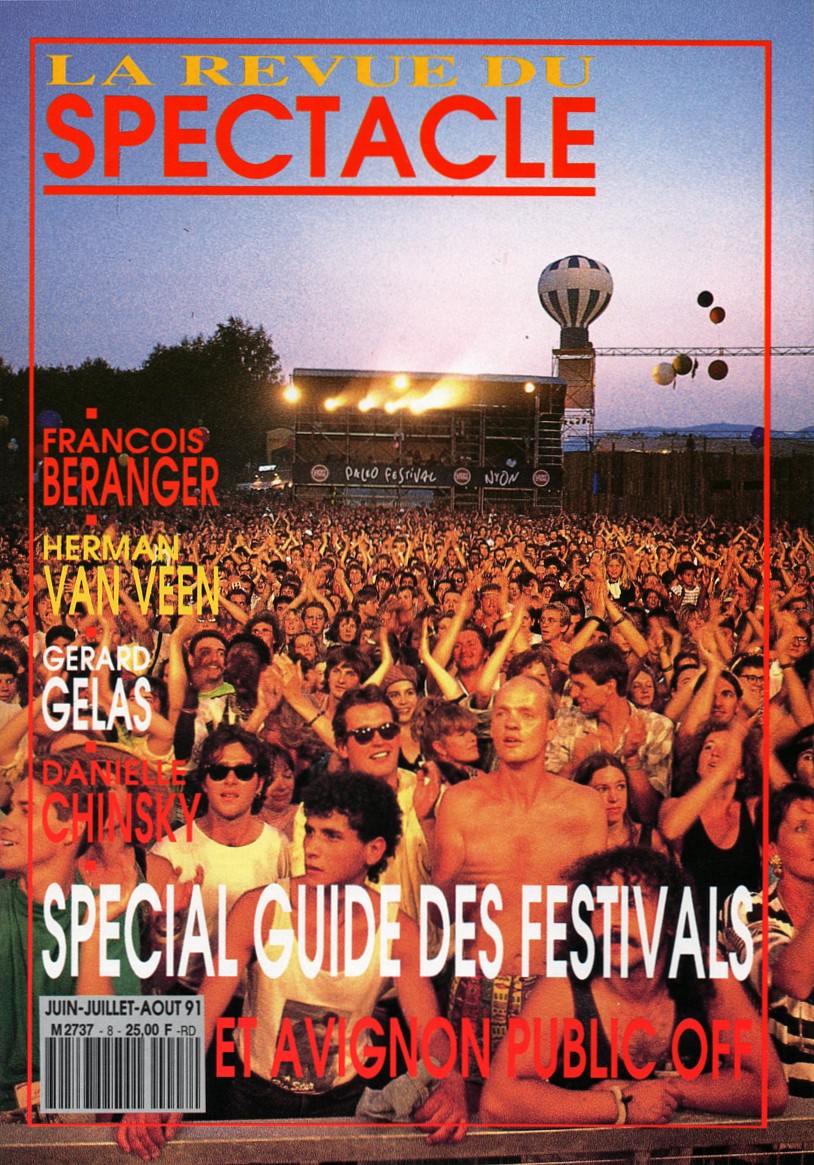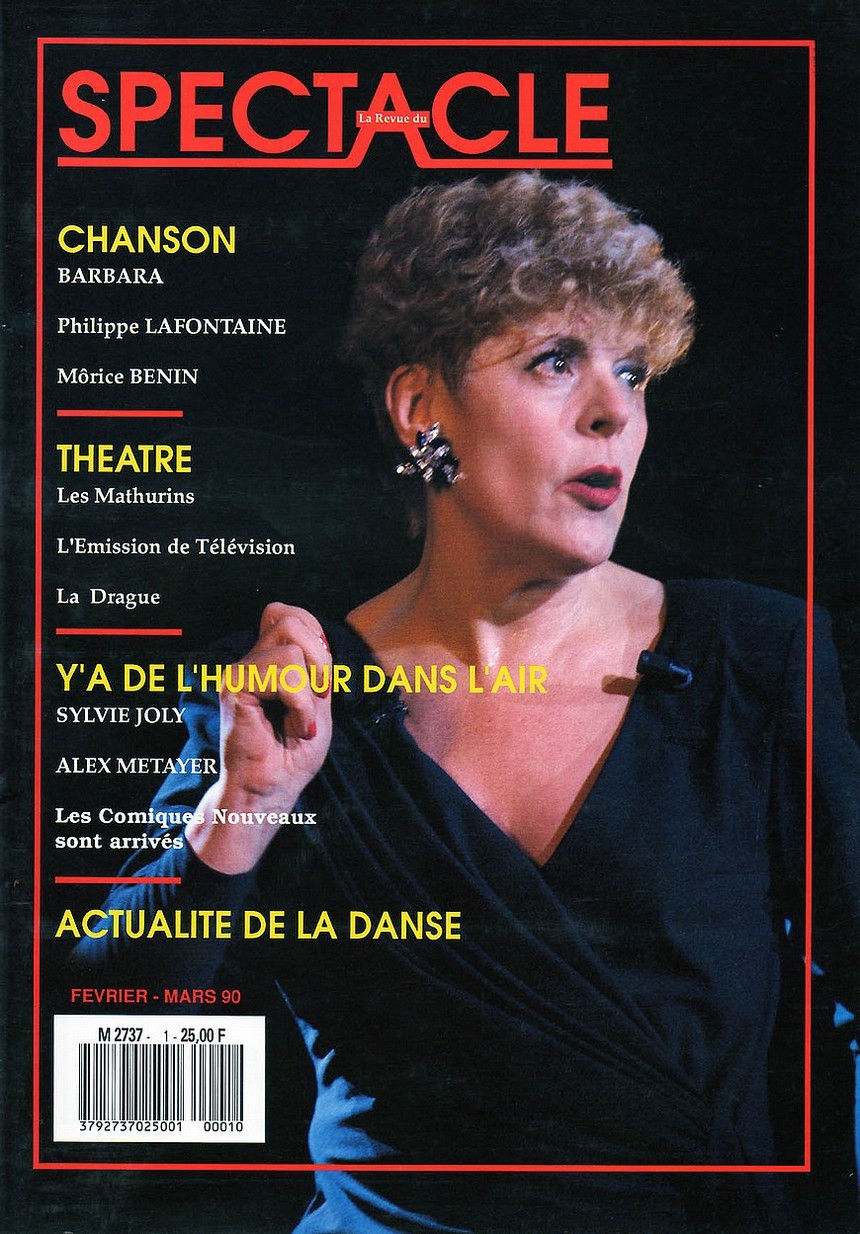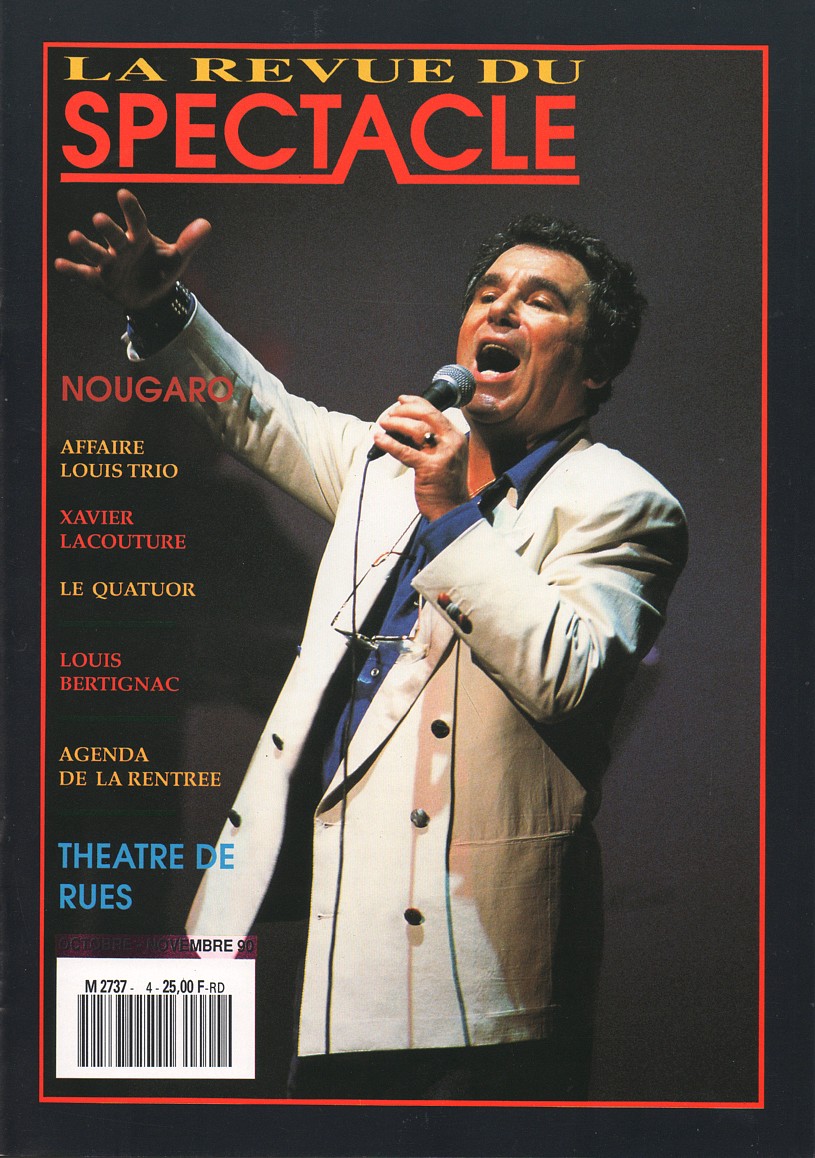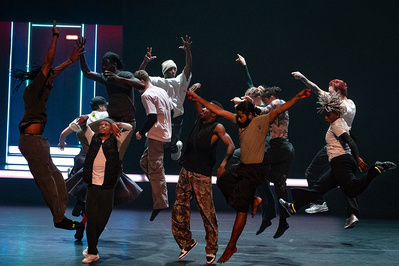Leornado DiCaprio et Clint Eastwood © 2011 Warner Bros.
Il est des films qui semblent n’avoir attendu qu’un réalisateur, et un seul, pour voir le jour. "J. Edgar" est de ceux-ci. Difficile en effet de trouver personnage plus "eastwoodien" que le fondateur du FBI, véritable concentré d’ambiguïtés politiques et intimes. Ambiguïtés que Clint Eastwood déroule avec soin, sans naturellement chercher à en lever aucune, tout au long d’un récit fait d’allers et retours temporels qui sont autant d’étapes dans la construction de l’homme John Edgar et de la légende Hoover. Son homosexualité, refoulée mais bien vécue – platoniquement ? -, au centre des polémiques entourant le film, n’étant qu’un des éléments du puzzle. Et pas obligatoirement le plus déterminant.
Résumons. En 1919, John Edgar Hoover, jeune diplômé en droit aux dents démesurées et à l’antibolchevisme chevillé au corps, n’a que 24 ans lorsqu’il est nommé directeur de la General Intelligence Division du département de la Justice. Il en sort cinq ans plus tard pour prendre la tête du Bureau of Investigation, qui deviendra en 1935 le Federal Bureau of Investigation, qu’il dirigera jusqu’à sa mort, en 1972, après avoir vu défiler huit présidents à la Maison Blanche.
Résumons. En 1919, John Edgar Hoover, jeune diplômé en droit aux dents démesurées et à l’antibolchevisme chevillé au corps, n’a que 24 ans lorsqu’il est nommé directeur de la General Intelligence Division du département de la Justice. Il en sort cinq ans plus tard pour prendre la tête du Bureau of Investigation, qui deviendra en 1935 le Federal Bureau of Investigation, qu’il dirigera jusqu’à sa mort, en 1972, après avoir vu défiler huit présidents à la Maison Blanche.

Naomi Watts et Leornado DiCaprio © 2011 Warner Bros.
Au cours de sa vie, partagée entre l’édification de la première agence fédérale de lutte contre le crime organisé, le montage de dossiers compromettants sur les personnalités publiques et l’écriture de sa propre hagiographie, Hoover n’aura eu que quatre amours, auxquels il sera resté fidèle jusqu’au bout : une Amérique dont il ne saisira pas les évolutions sociétales - son obsession paranoïaque du péril communiste lui interdira de voir en Martin Luther King autre chose qu’un agitateur rouge… -, une mère puritaine et abusive avec qui il vivra jusqu’au dernier souffle de celle-ci, une secrétaire particulière dont il ne se séparera jamais et à qui il confiera le soin de détruire ses précieux dossiers secrets et, enfin, Clyde Tolson, son ami, confident et sans doute amant, indéfectible bras droit dont il fera son légataire universel.

© 2011 Warner Bros.
Dire que John Edgar Hoover n’était que paradoxes est un euphémisme. Introverti sexuel presque maladif mais fréquentant assidûment les stars dévergondées d’Hollywood, homme de l’ombre mais mégalo tirant la couverture à lui et cherchant en permanence les flashs des journalistes, réactionnaire inoxydable mais défenseur acharné d’un fédéralisme centralisateur qui ferait de lui aujourd’hui l’ennemi juré des républicains des tea party… Avec le FBI, il met en place un système de fichage tentaculaire doublé d’une implacable machine à broyer quiconque est soupçonné de menées antiaméricaines, mais il invente aussi la police scientifique et rationalise les méthodes de lutte contre la criminalité.
Car sa créature, à laquelle il a dédié son existence, lui ressemble, évidemment. Et il la protège autant que lui-même. Ses barbouzeries et ses dossiers, constitués dans le but de faire pression sur ses adversaires, permettront avant tout à son agence de garder une certaine indépendance, quelles que soient la couleur et les idées politiques des présidents élus à la Maison Blanche. Témoin, ce passage récurent, du plus haut comique, qui ponctue chaque changement de président : J.E. Hoover est convoqué dans le bureau ovale, en règle générale pour une remise à plat du rôle du FBI. Parfois, il est même question du remplacement de son directeur. Une entrevue avec "dossier chaud" sous le bras plus tard, il est reconduit dans ses fonctions avec carte blanche... Au début du film, Roosevelt accueille le jeune loup d’un très sec "Entrez, Mr Hoover". À la fin, c’est avec un "Hi Edgar" désabusé que Nixon accueille, sans illusions, l’homme le plus puissant du pays…
Car sa créature, à laquelle il a dédié son existence, lui ressemble, évidemment. Et il la protège autant que lui-même. Ses barbouzeries et ses dossiers, constitués dans le but de faire pression sur ses adversaires, permettront avant tout à son agence de garder une certaine indépendance, quelles que soient la couleur et les idées politiques des présidents élus à la Maison Blanche. Témoin, ce passage récurent, du plus haut comique, qui ponctue chaque changement de président : J.E. Hoover est convoqué dans le bureau ovale, en règle générale pour une remise à plat du rôle du FBI. Parfois, il est même question du remplacement de son directeur. Une entrevue avec "dossier chaud" sous le bras plus tard, il est reconduit dans ses fonctions avec carte blanche... Au début du film, Roosevelt accueille le jeune loup d’un très sec "Entrez, Mr Hoover". À la fin, c’est avec un "Hi Edgar" désabusé que Nixon accueille, sans illusions, l’homme le plus puissant du pays…

Leornado DiCaprio et Armie Hammer © 2011 Warner Bros.
Eastwood, on s’en doute, se régale de cette dualité, construisant un personnage à la fois détestable et émouvant, antipathique et attachant, grandiose et pathétique, dangereux et salutaire. Pour finalement, au détour d’une scène presque anodine entre Hoover et Clyde Tolson vieillissants, nous dire qu’il ne faut pas forcément croire ce qu’il vient de nous montrer pendant deux heures, et que son film, après tout, ne pourrait n’être qu’une manipulation supplémentaire…
Pied de nez réjouissant d’un acteur-créateur qui, à bientôt 83 ans, avec derrière lui soixante ans de carrière et trente-deux réalisations au compteur, n’a plus rien à prouver. Les esthètes qui ne voyaient dans son inspecteur Harry qu’un salopard d’extrême-droite ont pris leur retraite de critiques respectables ou retourné leur veste depuis longtemps. Il peut, désormais, s’amuser ouvertement avec cette ambiguïté qu’il a toujours lui-même cultivée, s’attachant à n’être, au fond, jamais où on l’attendait vraiment.
Pied de nez réjouissant d’un acteur-créateur qui, à bientôt 83 ans, avec derrière lui soixante ans de carrière et trente-deux réalisations au compteur, n’a plus rien à prouver. Les esthètes qui ne voyaient dans son inspecteur Harry qu’un salopard d’extrême-droite ont pris leur retraite de critiques respectables ou retourné leur veste depuis longtemps. Il peut, désormais, s’amuser ouvertement avec cette ambiguïté qu’il a toujours lui-même cultivée, s’attachant à n’être, au fond, jamais où on l’attendait vraiment.

© 2011 Warner Bros.
Épaulé par un DiCaprio époustouflant, y compris sous son maquillage de momie, Clint Eastwood signe donc un biopic qui ne ressemble à aucun autre, ni portrait à charge d’un personnage pour le moins controversé, ni statue élevée à un héros national, et encore moins biographie molle ne sachant sur quelle chaise poser son cul. Bien au contraire, dans la forme comme dans le fond, "J. Edgar" assume et épouse la personnalité complexe de son "héros", ses zones obscures, sa volonté de brouiller les cartes.
Hoover a servi - ou plutôt s’est servi de - huit présidents, a fait espionner des millions d’Américains, des plus anonymes aux plus célèbres, n’a pas fréquenté que des citoyens à l’honnêteté irréprochable, et peut être vu comme le précurseur des "Experts", de la politique spectacle et des "plombiers" du Watergate, entre autres... Dans cette vie étonnante, Eastwood ne cherche pas une vérité historique, mais l’essence d’un homme qui a traversé la quasi-totalité de l’Histoire du XXe siècle - à part la chute de l’URSS et Ben Laden, il n’a pas raté grand chose - en y participant très activement.
Hoover a servi - ou plutôt s’est servi de - huit présidents, a fait espionner des millions d’Américains, des plus anonymes aux plus célèbres, n’a pas fréquenté que des citoyens à l’honnêteté irréprochable, et peut être vu comme le précurseur des "Experts", de la politique spectacle et des "plombiers" du Watergate, entre autres... Dans cette vie étonnante, Eastwood ne cherche pas une vérité historique, mais l’essence d’un homme qui a traversé la quasi-totalité de l’Histoire du XXe siècle - à part la chute de l’URSS et Ben Laden, il n’a pas raté grand chose - en y participant très activement.

Naomi Watts © 2011 Warner Bros.
Qu’il s’agisse de réalité ou de fiction, le réalisateur de "Invictus" semble de plus en plus convaincu que l’on ne peut comprendre le sens des événements que si l’on comprend la nature des hommes qui y prennent part. À l’heure de l’information instantanée qui vide les faits de leur signification et des Wikileaks divers qui dévident des "révélations" comme on dévide de la saucisse, c’est réconfortant. Clint Eastwood est peut être un dinosaure. Mais un dinosaure doté d’un cerveau bien moins reptilien que nombre d’homo sapiens dernier cri.

Leornado DiCaprio et Judi Dench © 2011 Warner Bros.
● J. Edgar
Production et réalisation : Clint Eastwood.
Scénario : Dustin Lance Black.
Musique : Clint Eastwood.
Directeur de la photographie : Tom Stern.
Avec : Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Judi Dench, Lea Thompson, Ed Westwick.
En salles depuis le 11 janvier 2012.
Production et réalisation : Clint Eastwood.
Scénario : Dustin Lance Black.
Musique : Clint Eastwood.
Directeur de la photographie : Tom Stern.
Avec : Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Judi Dench, Lea Thompson, Ed Westwick.
En salles depuis le 11 janvier 2012.