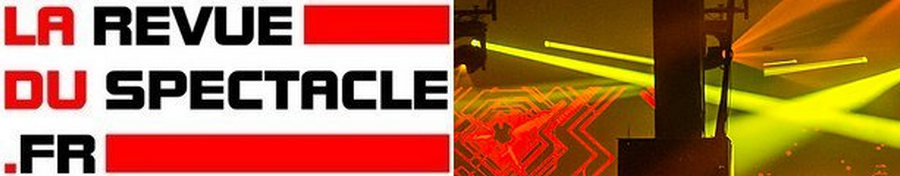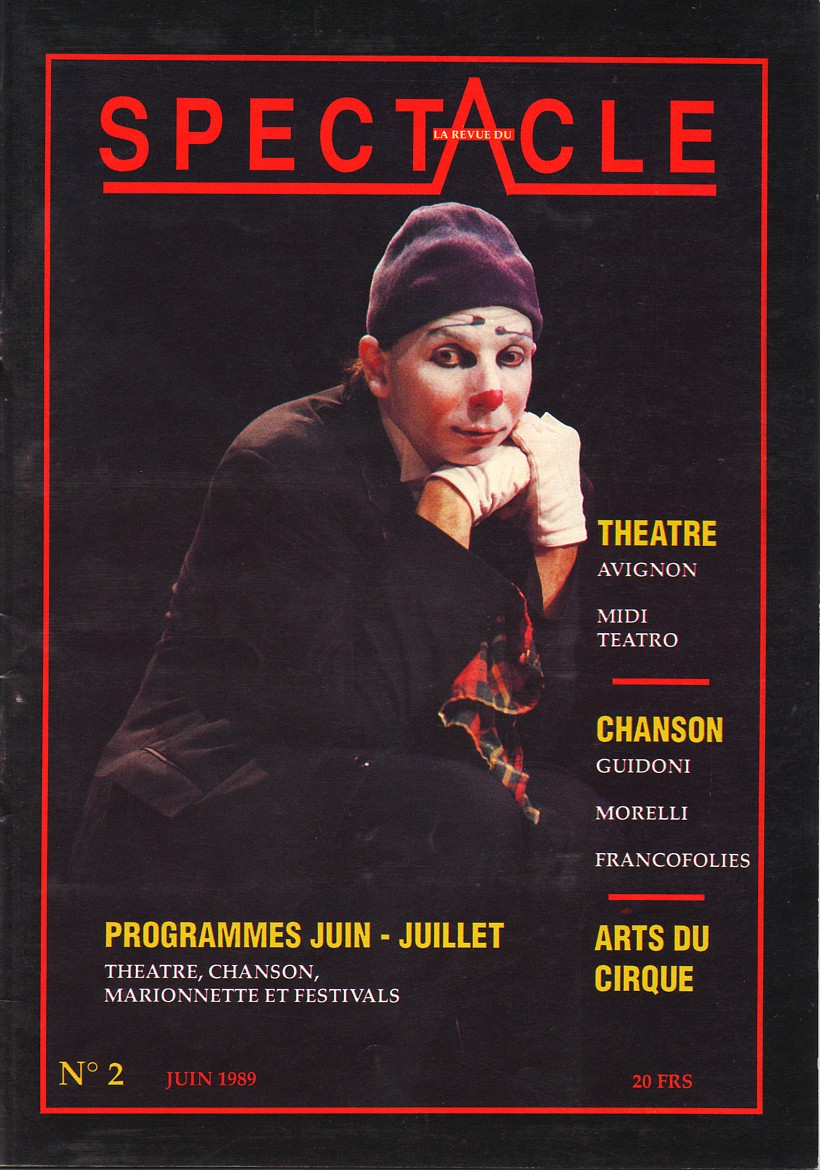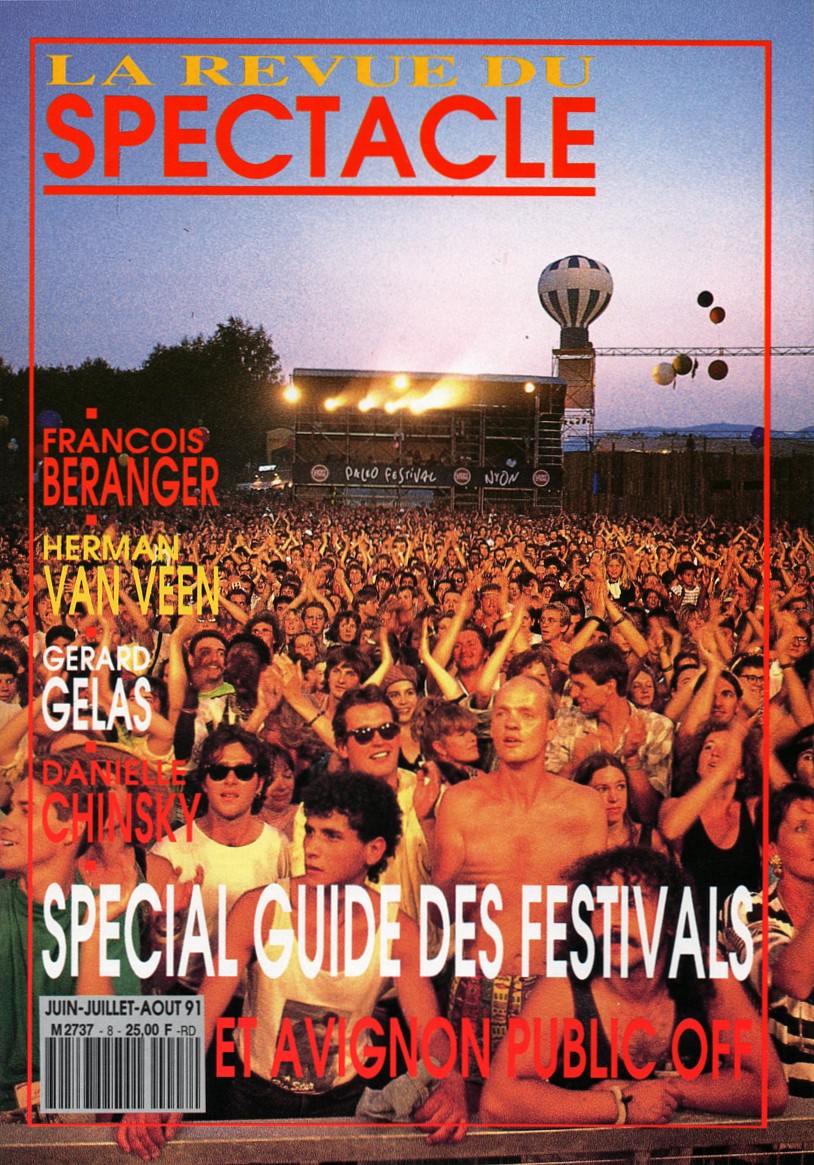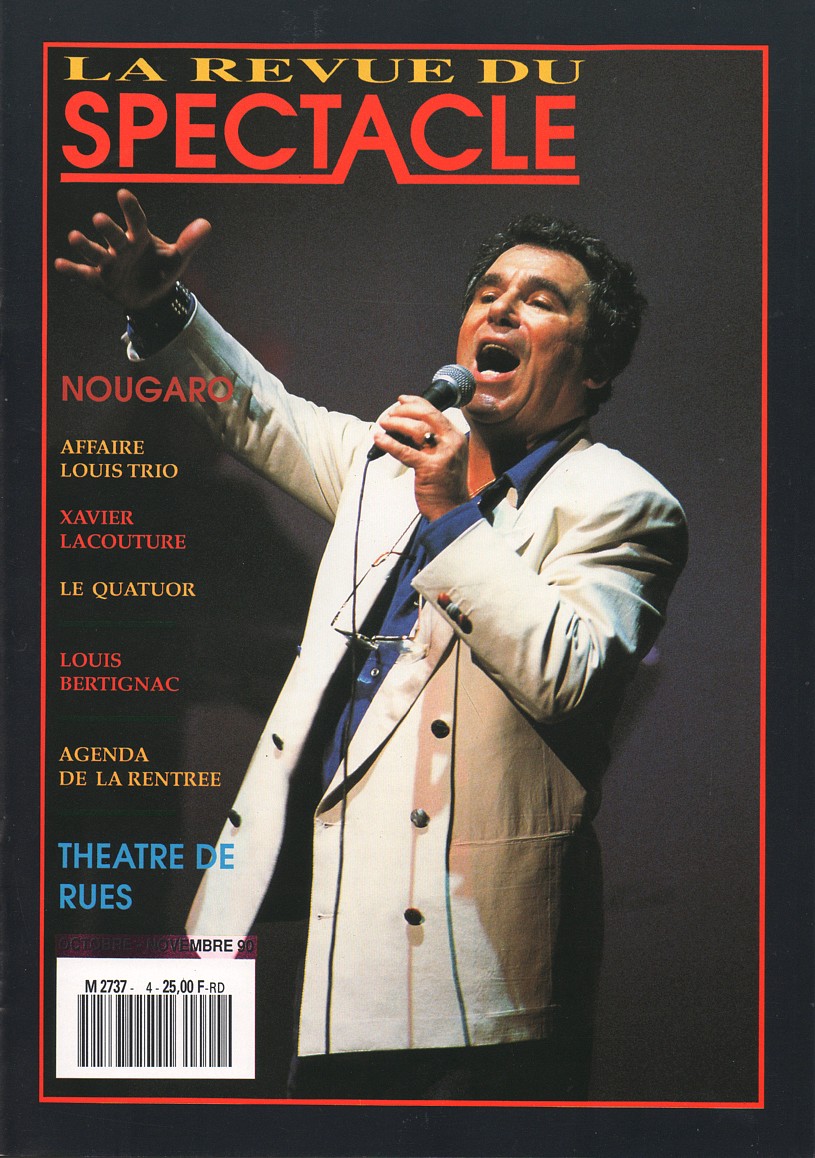© Pascal Victor.
D’abord, c’est la meilleure pièce de Jean Racine. Une pièce masculine, romaine et politique après les chants de "Andromaque" et "Bérénice". "Britannicus", une tragédie efficace : peu de personnages, quatre hommes, trois femmes, cinq actes, trente-trois scènes plutôt brèves, 1768 vers et pas un de trop (3), enchaînés implacablement dans une diabolique nécessité vers la catastrophe finale. Une horloge infernale de précision, un chef d’œuvre qui vous méduse à la fin.
Jean-Louis Martinelli livre une production de deux heures vingt sans entracte. Il a raison. La scène - c’est à dire l’antichambre de Néron - est une prison et les échappées vers l’extérieur inexistantes. Tous piégés. La lecture qu’en propose le directeur des Amandiers est convaincante. Les enjeux du texte mis en lumière, passionnants.
La scène est le plus souvent obscure, cernée par de grands piliers carcéraux, avec au fond l’entrée dans les appartements de l’empereur, mais aveuglée par un grand mur infranchissable. Entrée devant laquelle Néron tirera parfois un grand rideau écarlate. De la même teinte sanglante que son manteau de soie, ouvert sur son torse nu.
Jean-Louis Martinelli livre une production de deux heures vingt sans entracte. Il a raison. La scène - c’est à dire l’antichambre de Néron - est une prison et les échappées vers l’extérieur inexistantes. Tous piégés. La lecture qu’en propose le directeur des Amandiers est convaincante. Les enjeux du texte mis en lumière, passionnants.
La scène est le plus souvent obscure, cernée par de grands piliers carcéraux, avec au fond l’entrée dans les appartements de l’empereur, mais aveuglée par un grand mur infranchissable. Entrée devant laquelle Néron tirera parfois un grand rideau écarlate. De la même teinte sanglante que son manteau de soie, ouvert sur son torse nu.

© Pascal Victor.
Les ténèbres de la scène ? Ce sont peut-être celles de l’âme, ou celles du théâtre intérieur des pulsions irrémissibles des personnages et surtout de l’héritier des Julio-Claudiens, digne descendant des Caligula, des Tibère, d’Agrippine. Va s’y jouer ce que les grands scrutateurs des mammifères (que nous sommes) ont toujours montré - Sophocle, Shakespeare, Racine, etc. - que l’exercice du pouvoir se fait en famille, que l’inceste et la mort sont au cœur de la libido dominandi amoureuse et politique, qu’il faut anéantir cette famille pour lui survivre. Loi éternelle des grands fauves politiques. Et puis occasion aussi pour Racine de tuer le trop célèbre père sur son propre terrain - Pierre Corneille - à la cour de Louis XIV. Des Œdipe en cascade…
Au centre de la scène, vide, un parquet en forme de cercle tourne très lentement d’acte en acte : la fortune des uns, la chute des autres, la révolution de soleil (ou unités de temps et de lieu aristotélicienne). Le cycle infernal des révolutions de palais et le poids du passé. Un grand cirque où tous se dévorent et d’où les plus faibles (Britannicus, Junie) tenteront de s’échapper. Seul un fauteuil de style Richelieu, que chacun essaie d’occuper ou de contrôler tour à tour, rappelle qu’un trône se conquiert aux dépens d’une mère (Anne d’Autriche) ou d’un frère - même pour un roi-soleil.
Choc immense, frisson dans le dos, "tambos" (4) sacré : c’est l’Agrippine d’Anne Benoît, dès la première scène. Elle nous agrippe jusqu’au bout, et on ne pourra plus lui échapper. Comme Néron, lassé de "ses trois ans de vertu" et de la terreur que la mater genitrix lui inspire. Miracle, nous voilà tous transportés en 55 après JC, à Rome ! Combien de fois cela m’est-il arrivé dans ma - déjà - longue vie de spectatrice ? Deux fois ? Trois ? De l’étonnement douloureux du début (constat de son déclin et son fils la hait), ce fils "ingrat", pour lequel elle a commis le pire, l’écarte du trône. Jusqu’à son impérial aveuglement face au conseiller Burrhus, gentil Machiavel, face au fragile traître, Narcisse : Agrippine fascine comme jamais. De mémoire de spectatrice, qui a su aussi impérieusement renvoyer Néron à l’acte V, devenu meurtrier de son demi-frère, Britannicus : "Adieu. Tu peux sortir." que Anne Benoît, géniale Agrippine ? Après le sarcasme grandiose : "Poursuis, Néron, avec de tels ministres…".
Au centre de la scène, vide, un parquet en forme de cercle tourne très lentement d’acte en acte : la fortune des uns, la chute des autres, la révolution de soleil (ou unités de temps et de lieu aristotélicienne). Le cycle infernal des révolutions de palais et le poids du passé. Un grand cirque où tous se dévorent et d’où les plus faibles (Britannicus, Junie) tenteront de s’échapper. Seul un fauteuil de style Richelieu, que chacun essaie d’occuper ou de contrôler tour à tour, rappelle qu’un trône se conquiert aux dépens d’une mère (Anne d’Autriche) ou d’un frère - même pour un roi-soleil.
Choc immense, frisson dans le dos, "tambos" (4) sacré : c’est l’Agrippine d’Anne Benoît, dès la première scène. Elle nous agrippe jusqu’au bout, et on ne pourra plus lui échapper. Comme Néron, lassé de "ses trois ans de vertu" et de la terreur que la mater genitrix lui inspire. Miracle, nous voilà tous transportés en 55 après JC, à Rome ! Combien de fois cela m’est-il arrivé dans ma - déjà - longue vie de spectatrice ? Deux fois ? Trois ? De l’étonnement douloureux du début (constat de son déclin et son fils la hait), ce fils "ingrat", pour lequel elle a commis le pire, l’écarte du trône. Jusqu’à son impérial aveuglement face au conseiller Burrhus, gentil Machiavel, face au fragile traître, Narcisse : Agrippine fascine comme jamais. De mémoire de spectatrice, qui a su aussi impérieusement renvoyer Néron à l’acte V, devenu meurtrier de son demi-frère, Britannicus : "Adieu. Tu peux sortir." que Anne Benoît, géniale Agrippine ? Après le sarcasme grandiose : "Poursuis, Néron, avec de tels ministres…".

© Pascal Victor.
La comédienne a la voix très grave, la présence impériale, impérieuse, le "Génie" qui fait trembler. Elle "est" Agrippine, elle est grande. Je le répète : elle nous rappelle ce que nous devons au théâtre, quand il est excellent. Tous les autres acteurs pâtissent un peu de son éclat mais la plupart sont bons : Alain Fromager compose - avec quelque chose d’un Al Pacino au mitan de son âge - un Néron déjà vieillissant mais encore chien fou. Si le parti-pris de donner le rôle d’un personnage, censé avoir dix-huit ans dans la pièce, à cet acteur étonne au début, on est cependant vite convaincu de la pertinence de ce choix. Pressé de ronger sa laisse, metteur en scène pervers et violent, il regarde les autres se mirer dans leurs illusions - un miroir d’eau dormante au centre de la scène - et sur leur vraie influence sur lui. Tout est déjà joué, ils sont déjà morts. Lui espère encore jouir. De Junie. Mais elle lui échappera. Personnage mûr, il est l’amant-jouet - croit encore Agrippine - qu’elle embrasse sur la bouche. Elle s’assoit sur lui et sur le trône - pas seulement au sens propre. Mais il attend son heure.
Les deux conseillers sont très bien : Burrhus avec la voix envoûtante et le physique un peu lourd de Jean-Marie Winling, et le frêle Narcisse de Grégoire Oestermann. La belle Junie se débat en vain et ne sauvera pas son amant. Elle est habilement interprétée par Anne Suarez. Seul bémol : le jeu artificiel de Britannicus/Éric Caruso et d’Albine/Agathe Rouiller. Quand ils parlent, c’est aux plus mauvais moments passés à la Comédie française qu’on pense : emphase inopportune et énonciation déclamatoire d’étudiants de deuxième année d’école de théâtre (mollo, please sur les "e" muets prononcés !). Il est vrai que dire des alexandrins, pourtant aussi admirablement cadencés que ceux-là, n’est pas à la portée de tout le monde. Pourtant nul besoin d’en faire trop, la langue racinienne est une parole vivante et naturelle à force de génie d’écriture : "J’ai voulu lui parler et ma voix s’est perdue" (v. 396).
Une pièce sublime, comme sa comédienne principale. Un metteur en scène intelligent - donc modeste - au service d’un texte dont il nous révèle encore la richesse inépuisable : croyez-moi, courez applaudir Agrippine, Racine et Martinelli ! Moi, j’y retourne.
Les deux conseillers sont très bien : Burrhus avec la voix envoûtante et le physique un peu lourd de Jean-Marie Winling, et le frêle Narcisse de Grégoire Oestermann. La belle Junie se débat en vain et ne sauvera pas son amant. Elle est habilement interprétée par Anne Suarez. Seul bémol : le jeu artificiel de Britannicus/Éric Caruso et d’Albine/Agathe Rouiller. Quand ils parlent, c’est aux plus mauvais moments passés à la Comédie française qu’on pense : emphase inopportune et énonciation déclamatoire d’étudiants de deuxième année d’école de théâtre (mollo, please sur les "e" muets prononcés !). Il est vrai que dire des alexandrins, pourtant aussi admirablement cadencés que ceux-là, n’est pas à la portée de tout le monde. Pourtant nul besoin d’en faire trop, la langue racinienne est une parole vivante et naturelle à force de génie d’écriture : "J’ai voulu lui parler et ma voix s’est perdue" (v. 396).
Une pièce sublime, comme sa comédienne principale. Un metteur en scène intelligent - donc modeste - au service d’un texte dont il nous révèle encore la richesse inépuisable : croyez-moi, courez applaudir Agrippine, Racine et Martinelli ! Moi, j’y retourne.
Notes :
(1) Certes, l’an dernier il y eut le "Danton" à la MC93.
(2) Cheville géniale au vers 395 dans la tirade de Néron à l’acte II, une parmi tant d’autres dans des alexandrins d’airain (Merci à S. Mullier !).
(3) On peut trouver le récit final d’Albine superfétatoire… En plus si c’est dit médiocrement, une vraie chute de tension. C’était le cas ici.
(4) Le "tambos" chez les Tragiques grecs, c’est le frisson sacré ressenti par les spectateurs quand le dieu se manifeste sur la scène.
(1) Certes, l’an dernier il y eut le "Danton" à la MC93.
(2) Cheville géniale au vers 395 dans la tirade de Néron à l’acte II, une parmi tant d’autres dans des alexandrins d’airain (Merci à S. Mullier !).
(3) On peut trouver le récit final d’Albine superfétatoire… En plus si c’est dit médiocrement, une vraie chute de tension. C’était le cas ici.
(4) Le "tambos" chez les Tragiques grecs, c’est le frisson sacré ressenti par les spectateurs quand le dieu se manifeste sur la scène.
"Britannicus"
Texte : Jean Racine.
Mise en scène : Jean-Louis Martinelli.
Assistante à la mise en scène : Amélie Wendling.
Avec : Anne Benoît (Agrippine), Éric Caruso (Britannicus), Alain Fromager (Néron), Grégoire Oestermann (Narcisse), Agathe Rouiller (Albine), Anne Suarez (Junie), Jean-Marie Winling (Burrhus).
Scénographie : Gilles Taschet.
Lumière : Jean-Marc Skatchko.
Costumes : Ursula Patzak.
Coiffures, maquillages : Françoise Chaumayrac.
Du 14 septembre au 27 octobre 2012.
Du mardi au samedi à 20 h 30, jeudi à 19 h 30, dimanche à 15 h 30.
Théâtre Nanterre-Amandiers, Salle transformable, Nanterre (92), 01 46 14 70 00.
>> nanterre-amandiers.com
Mise en scène : Jean-Louis Martinelli.
Assistante à la mise en scène : Amélie Wendling.
Avec : Anne Benoît (Agrippine), Éric Caruso (Britannicus), Alain Fromager (Néron), Grégoire Oestermann (Narcisse), Agathe Rouiller (Albine), Anne Suarez (Junie), Jean-Marie Winling (Burrhus).
Scénographie : Gilles Taschet.
Lumière : Jean-Marc Skatchko.
Costumes : Ursula Patzak.
Coiffures, maquillages : Françoise Chaumayrac.
Du 14 septembre au 27 octobre 2012.
Du mardi au samedi à 20 h 30, jeudi à 19 h 30, dimanche à 15 h 30.
Théâtre Nanterre-Amandiers, Salle transformable, Nanterre (92), 01 46 14 70 00.
>> nanterre-amandiers.com